
2-8-2018
Tu não és como as outras mães, de Angelika Schrobsdorff
|
NOTA DE LEITURA
Neste
livro, a escritora Angelika
Schrobsdorff narra a vida de
sua mãe Else, filha de
Daniel Kirschner e esposa Minna, Cohn em solteira, ambos judeus, nascida
em 30 de Junho de 1893
Else
recusou o noivo judeu que os pais tinham arranjado para ela e casou
às
escondidas com o ariano Fritz Schwiefert de quem teve o filho Peter em 5
de Janeiro de 1917. Os pais ficaram furiosos mas aceitaram a situação
quando o filho mais velho Siegfried (Friedel)
faleceu da gripe espanhola em 14 de Outubro de 1918.
A
fidelidade não
era virtude que Else tivesse e anos depois teve uma segunda filha do seu
amante Hans Huber que foi o
pai de Bettina, nascida a 8 de Junho de 1922.
Bettina Schwiefert usou sempre o
nome do primeiro marido e só
45 anos mais tarde
é
que soube que não
era filha de Fritz.
Conheceu depois Erich Schrobsdorff, de 28 anos, também
ariano. Para festejar o novo amante, Else planeou ir seis semanas de férias
com ele, mas Hans foi aos arames. Hans foi-se embora de vez da casa onde
todos viviam e esqueceu a filha que afinal não
tinha o nome dele.
Ficou
grávida
de Erich e em 24-12-1927 nasceu Angelika Schrobsdorff. Erich casou com
Else em 1930.
Estava
tudo bem, excepto para o pai de Erich que não
queria ter uma nora judia e para o filho mais velho de Else, Peter, que
não
queria ter padrasto nenhum.
Else
tardou muito a compenetrar-se da perseguição
aos judeus que ai vinha. Decidiu-se depois ir para a Bulgária, e Else casou com um búlgaro. Mas o filho Peter quis ir para Portugal, para Faro. Dimiter Lingorsky o nome do búlgaro que aceitou o casamento e foi pago para isso
Em Outubro de 1939 faleceu o pai
dela, Daniel Kirschner de
pneumonia.
Em 2
de Março
de 1941, os alemães
entraram na Bulgária
e a mãe e as duas filhas já
não
estavam em segurança.
A
perseguição
racial chegou
à
Bulgária
e tiveram de casar Bettina com o namorado búlgaro
Mitso, para que não
fosse presa (tinha atingido a maioridade). Peter
chegara a Israel, tendo sido expulso de Portugal por se declarar judeu,
pelo menos assim o dizia. Receberam a not ícia de que a mãe Minna (nascida em 1863) com todos os outros do lar judeu fora mandada para Theresienstadt, onde foi executada, Viveu 4 meses no campo e foi cremada em 14/15 de Dezembro de 1942. Não se sabe se foi cremada viva ou morta, mas possivelmente estava viva.
Sófia
foi bombardeada. Tiveram de refugiar
em
Bujovo, a uns 50 Km.
7-5-1945
–
A Alemanha capitulou em 7 de Maio de 1945. Ingleses e americanos
ocuparam Sófia
Sem a mãe
saber, Peter tinha ido para a guerra onde tombou em
7 de Janeiro de 1945.
Ainda antes de saírem
das Bulgária
foi diagnosticada a Else esclerose múltipla.
Tinha já
sofrido uma paralisia facial que lhe tinha deformado o rosto.
Angelika, a autora, acompanhava primeiro com ingleses e depois com
americanos. Em 1946 foi
desflorada e violada por um coronel americano. No final do Ver ão de 1947, Else regressa da Bulgária à Alemanha. Morreu em 5 de Junho de 1949------------------------------+---------------------------------- Angelika Schrobsdorff faleceu em 30 de Julho de 2016 em Berlim, com a idade de 88 anos.
O Tio de Angelika, Walter, tinha
definido assim as duas irmãs:
A Bettina parece um diabinho e
é
um anjo, a Angelika parece um anjo e
é
um diabinho. ------------------------------+----------------------------------
Bettina nasceu em 8 de Junho de 1922 e na realidade o seu verdadeiro pai
foi Hans Huber, mas foi registada com o nome do marido da mãe; só nos
anos 60 é que teve conhecimento da sua verdadeira paternidade.
Quando vivia na Bulgária com sua mãe, ao atingir a maioridade foi-lhe
comunicado pêlos Alemães que iria ser enviada para um campo de
concentração (KZ) na Polónia por ser meia judia. Foi decidido então
casá-la com o seu namorado
Димитър
Константинов
Станишев
(3-3-1906 † 8-11-1995) ou Dimitri Konstantinov Stanishev, um médico e
professor mais velho que ela 16 anos e assim obteve a nacionalidade
búlgara. O casamento teve lugar em Março de 1943. Mas em 20 de Dezembro
desse mesmo ano foi bombardeada a casa onde se encontrava seu marido que
ficou gravemente ferido; nessa altura já ela estava
grávida quase a findar a gestação de seu filho André que nasceu
no início de 1944.
Acabada a Guerra foi ela perseguida e presa pela Milícia búlgara
(certamente telecomandada pêlos Russos) em virtude da ser Alemã. Foi
depois libertada e foi viver com seu marido e filho para Plovdiv. Hoje
Andrey Stanishev -
Андрей
Станишев
é um artista conhecido nesta mesma cidade.
Em 1950 Bettina teve uma filha
Евелина
(Ева)
Димитрова
Станишева
– Evelina Dimitrova Stanisheva que hoje é médica em Burgas, tendo casado
com Pencho Penchev.
Certamente Bettina não era feliz na Bulgária onde tanto tinha sofrido e
não podia sequer vir à Alemanha, devido à Cortina de Ferro. Em 1965
conseguiu autorização para visitar Munique por três meses com sua filha
Evelina; foi-lhes permitida outra visita em 1967. Mas em 1969 veio
sozinha pois não permitiram que sua filha viajasse. A seguir pôde viver
na Alemanha até 2001 mediante autorização escrita de seus dois filhos.
Em Agosto de 2001 regressou à Bulgária e foi viver para Burgas perto de
sua filha. Nessa altura já tinha caído o regime comunista em 10 de
Novembro de 1989. Bettina faleceu em 28 de Outubro de 2007.
|
Medidas contra os judeus promulgadas em 1938 (Pag. 258 da edição
alemã):
Os Judeus devem ser portadores de cartão
identificativo
a partir de 1.1.1939
Os médicos
Judeus serão
considerados, a partir de 30-9-1938 meros
“cuidadores
de doentes”
Todos os nomes Judeus de ruas deverão
ser retirados
Os Judeus não
poderão
ter nomes próprios
Judeus a partir de 1-1-1939. No caso de terem nomes alemães,
deverão
adoptar também
os nomes
“Israel”
e
“Sara”,
respectivamente.
Os passaportes Judeus deverão
ser assinalados com um J maiúsculo
Cerca de 15 000
“Judeus
“
apátridas
serão
expulsos para a Polónia.
É
proibido aos Judeus andarem armados, bem como a posse de armas
É
imposta ao conjunto de todos os Judeus uma prestação
de desagravo no valor de mil milhões
de marcos do Reich.
Os Judeus deverão
eliminar imediatamente, e a expensas próprias,
todos os prejuízos
resultantes do pogrom
- a chamada Noite de Cristal.
Os Judeus não
podem deter negócios
nem empresas artesanais.
É
proibida aos Judeus a frequência
de teatros, cinemas, concertos e exposições.
Todas as crianças
judias serão
afastadas das escolas alemãs
Todas as empresas judias serão
liquidadas.
É
proibida aos Judeus, com efeito imediato, a circulação
a determinadas horas, em determinadas
zonas.
Os Judeus devem vender as
suas empresas, os seus títulos
de valores e as suas jóias.
É
proibida aos judeus a frequência
de universidades

Expresso n.º 2384, de 7-7-2018
TU NÃO ÉS COMO AS OUTRAS MÃES
Angelika Schrobsdorff
Alfaguara, 2018,
trad.
de Helena Topa, 566 pgs
Romance
É a partir de meia dúzia de caracóis castanhos, cor de mel, vermelho acobreados,
todos cortados
em
tenra idade e guardados num álbum de infância, que um
dia Angelika resolve fazer uma longa trança de memórias sobre a mãe:
“Quando
conheci Else, a minha mãe, o cabelo dela era acobreado e forte como a crina de
um cavalo. Tinha sempre um ar despenteado, mesmo quando acabava de chegar do
cabeleireiro. Os caracóis, fartos, cortados curtos eram difíceis de domar. Não
era a única coisa difícil de domar nela. Gostava de ter herdado os cabelos e a
vitalidade que tinha.” Este quase preâmbulo encerra
em
si um
caderno de encargos: a feitura de
um
retrato por alguém que desde o início assume que o
resultado final não será nítido. Por conveniência e por opção. “Tu não és como
as outras mães” poderia chamar-se “O mistério Else”. Os fios narrativos
—
realidade histórica e
biografia
ficcionada
— correm
paralelos. Durante mais de 500 páginas, Angelika Schrobsdorff (1927-2016) tenta,
num exercício de alto risco, que estes planos não se contaminem, que sejam
autónomos. Tarefa tanto mais difícil quanto o meio século de que aqui estamos a
falar corresponde a
primeira
metade do século XX na Alemanha. Else nasceu judia rica, cresce cristã e pobre
por opção, descobre a sexualidade na euforia dos loucos anos 20, vive vários
triângulos amorosos bastante esdrúxulos. 0 livro divide-se em duas partes,
‘Completamente diferente’ e ‘Fiasco’, e ainda um epílogo onde se juntam algumas
cartas, folhas soltas, apêndices da narrativa. A escrita é magistral: cirúrgica
e precisa, mas também evasiva e pouco conclusiva. Há uma mãe coragem que precisa
de ser homenageada, mas paira também uma sombra de ajuste de contas. Só muito
raramente Angelika descreve a mãe olhos nos olhos. A excepção são os momentos em
que o tempo corrói a máscara. Por exemplo, lá para o fim da II Guerra Mundial,
quando Else é forçada a viver na Bulgária: “O rosto, que continuava moreno,
porque se sentava muitas vezes ao sol, estava aplanado e tenso devido à
paralisia
do lado direito, do lado esquerdo estava decaído. Apesar da destruição não era
um rosto feio, era apenas um rosto infinitamente triste.” Angelika Schrosbsdorff
foi casada com o realizador Claude Lanzmann, autor do célebre documentário
“Shoah”, com quem viveu durante 23 anos em Israel.
Rui Lagartinho
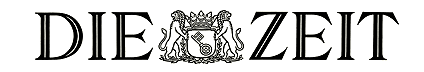
Besprechung von 06.12.2016
Angelika Schrobsdorff: Du bist nicht so wie andre Mütter. Die Geschichte einer
leidenschaftlichen Frau. dtv, München 2016. 589 Seiten
Eine Mutter in Krieg und Exil
Else Kirschner war ein sturer Freigeist. Als Jüdin dürfe sie keinen Christen
heiraten? Nicht mit ihr. Angelika Schrobsdorff, die im Juli in Berlin starb,
erzählt in ihrem nun neu aufgelegten Bestseller aus dem Jahr 1992 vom bewegten
Leben ihrer Mutter. Von deren überbehüteter Jugend, dem Bruch mit der Familie,
der Heirat. Aus Briefen und Gesprächen setzt sie das von zwei Weltkriegen
geprägte Leben Stück für Stück zusammen. Den Erzählungen stellt sie ihre eigenen
Erinnerungen an die Mutter gegenüber, gleicht deren persönliche Entscheidungen
rückblickend mit den sich überschlagenden historischen Ereignissen ab. Die
gemeinsame Flucht vor den Nazis, das Exil in Bulgarien und die Rückkehr nach
Berlin markierten eine tiefe Zäsur im Leben von Mutter und Tochter.
Schrobsdorff verklärt
dabei ihre Mutter nicht. Sie bewahrt immer eine ironische Distanz, die von
tiefer Zuneigung zeugt, und gibt damit en passant auch viel von sich selbst
preis. Es entsteht ein plastisches, liebevolles, aber auch
kritisches Porträt einer Frau, die angesichts
von Krieg und kultureller Heimatlosigkeit immer versuchte, sich selbst treu zu
bleiben.
SOFIA GLASL
![]()
2. August 2016,
Berlin (dpa)
- Es war ein spannendes und erfolgreiches, aber wohl auch ein tieftrauriges
Leben. "Ich habe keine Worte mehr, ich bin einsam, leer, einsam, einsam,
einsam", gestand die Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff schon vor Jahren.
Ihre vielen beliebten Bücher, selbst ihren Bestseller "Du bist nicht so wie
andre Mütter" ließ sie nicht als Trost gelten. Am Samstag (30. Juli) ist die
Autorin mit 88 Jahren in Berlin gestorben, wie ihr Verlag am Dienstag
bestätigte.
Nach langer Zeit in Paris und fast einem Vierteljahrhundert in Jerusalem war
Schrobsdorff vor zehn Jahren in ihre alte Heimat zurückgekehrt. "Es stirbt sich
bequemer in Berlin und leichter in der eigenen Sprache", sagte sie damals in
einem Gespräch mit der "Berliner
Zeitung".
Der dtv Verlag würdigte sie als "unerschütterliche, unbestechliche und
streitbare Frau".
1927 als Tochter eines wohlhabenden Berliner Bauunternehmers und einer
assimilierten Jüdin in Freiburg geboren und zunächst behütet im Grunewald
aufgewachsen, musste sie 1939 mit ihrer Mutter vor der Nazis nach Bulgarien
fliehen - die Familie väterlicherseits wollte die "jüdische Belastung"
loswerden. Ihre
Großeltern wurden während der Schoah in Theresienstadt ermordet.
Die Zäsur durch Krieg und Nazizeit beschrieb Schrobsdorff später in dem Roman
"Du bist nicht so wie andre Mütter" (1992), der mit Katja Riemann in der
Hauptrolle verfilmt wurde. Auch in anderen Werken verarbeitete sie immer wieder
eigene Erfahrung. "Sie erzählt, was sie erlebt hat, und sie erzählt es mit
Distanz und zärtlicher Ironie", schrieb die große französische Kollegin Simone
de Beauvoir im Vorwort zu Schrobsdorffs Erzählband "Die Reise nach Sofia"
(1983).
1947 kehrte sie nach Deutschland zurück und begann wenige Jahre später nach
einer schweren persönlichen Krise zu schreiben. Ihr erster Roman "Die Herren"
sorgte wegen seiner Freizügigkeit für Aufruhr. Weitere wichtige Werke waren etwa
"Die kurze Stunde zwischen Tag und Nacht" (1978), "Jericho, eine
Liebesgeschichte" (1995) und "Grandhotel Bulgaria" (1997).
Nach einer gescheiterten Ehe mit dem französischen Filmemacher Claude Lanzmann
("Shoah") wandert Schrobsdorff 1983 nach Jerusalemaus.
Doch auch dort wird sie nicht wirklich glücklich. Weil sie "aus
Gerechtigkeitssinn", wie sie sagt, für die Palästinenser Partei ergreift, gilt
sie bei den Israelis bald als Nestbeschmutzerin und Querulantin. Einige ihrer
Bücher sind bis heute nicht auf Hebräisch erschienen.
Als die Autorin 2006, verbittert über die politische Lage in Israel nach Berlin zurückkehrt, ist sie eine gebrochene Frau. Sie hat sich ihre lange so freizügig gelebte Lust "abgeschnitten", hadert mit dem Alter und leidet unter Schreibblockade. "Der Vogel hat keine Flügel mehr" heißt bezeichnenderweise ihr letztes Buch mit Briefen des Halbbruders an die gemeinsame Mutter. Wie sagte sie einmal zu ihrer Rückkehr nach Berlin? "Ich bin nicht gekommen, um hier zu leben, sondern um hier zu sterben."

Par Marianne Payot, publié le 07/06/2004
Racontée par sa fille, l'étonnante vie d'Else Kirschner, femme libre dans le
Berlin des années 1930.
Qu'elle devra quitter pour fuir le nazisme...
Il est des femmes que l'on aurait aimé rencontrer, écouter, admirer. Des femmes
comme Else Schrobsdorff, syncrétisme de tout ce qu'une certaine Europe d'un
moment particulier du XXe siècle a pu offrir de meilleur: l'amour des arts et de
la littérature, la jouissance de la vie, la passion de la liberté. C'est sa
fille, Angelika, une fille pas comme les autres elle non plus, qui nous livre,
avec honnêteté, le portrait de ce petit bout de femme flamboyant.
Publié en Allemagne en 1992, Tu n'es pas une mère comme les autres, 500
pages serrées, nous arrive enfin, déployant, dans une traduction impeccable, les
heurs et malheurs du Berlin des gens d'esprit. 30 juin 1893-5 juin 1949: entre
ces deux dates, Else Kirschner aura multiplié les galants et les amants, enfanté
trois fois de trois pères différents, embrassé la religion chrétienne, participé
plus que de mesure aux Années folles et subi la folie nazie. Nul ne saura jamais
ce qui poussa cette jeune fille juive de bonne famille à mener cette vie
«tarabiscotée», pour reprendre un des mots préférés de sa mère, Minna.
Noces berlinoises. Elevée
avec force cours de piano, de violon et de français, Else se voit promise à
Alfred, un bon parti, confectionneur comme son père. Mais, attirée par «le monde
de la liberté et des chrétiens», elle jette son dévolu sur Fritz Schwiefert, un
poète aux longs cheveux bruns, spirituel, cultivé et sans argent. Février 1916:
elle s'échappe de la maison familiale pour rejoindre son artiste, donne
naissance à un petit Peter, se réconcilie avec sa famille, organise ses
premières fêtes.
Bientôt, plus que les atrocités de la Première Guerre mondiale, ce sont les
infidélités de son mari qui la laissent groggy. Pas pour longtemps. La voilà
dans les bras de Hans Huber, le fils du ministre bavarois de l'Agriculture, à
qui elle propose, tout bonnement, la cohabitation à quatre. Durant quatre ans,
Else, Hans, Fritz et Enie, sa baronne de maîtresse, vont transformer leur drôle
de foyer en lieu de ralliement de tous les noceurs berlinois. Il faudra
attendre, non pas l'enfant qu'Else aura de Hans, mais le bel Erich Schrobsdorff,
riche fils de junker prussien, pour que le quatuor éclate en morceaux.
Après de longues années d'insouciance, Else, tout juste mère d'Angelika, se
résout à l'évidence: les Allemands ne sont pas qu'un peuple de poètes et de
penseurs. S'ensuivent, pour la singulière juive et ses descendants, l'exil en
Bulgarie, le chaos, l'indigence et la maladie, vécue comme «une sorte de
châtiment mérité». L'histoire d'amour entre Else et l'Allemagne est à jamais
terminée. Plus tard, à son tour, Angelika s'expatriera, à Paris - où elle sera,
un temps, mariée à Claude Lanzmann - puis à Jérusalem.
Laissant derrière elle nombre de galants

CRITIQUE
— 8 juillet 2004
Enfant, Else préférait «l'histoire de l'Enfant Jésus», «un Dieu sans visage ni
famille ne lui disait rien du tout», écrit Angelika Schrobsdorff. Else était la
mère d'Angelika, de Bettina et de Peter Schwiefert (1), qui a donné ces mots au
titre de ce titre.
Trois enfants nés de trois pères différents.
Else n'est pas «une mère comme les autres», dans l'entre-deux-guerres
d'Allemagne. Ni une jeune fille comme des milliers de demoiselles juives nées
dans le milieu solide, mais ennuyeux, affectueux, mais conformiste, de
confectionneurs vaguement inquiets dans une société qui fait mine de les
accepter, mais les écarte de manière subtile. Else, prisonnière de son milieu
mais attachée à sa famille, s'évade dans un «vaste monde, le monde de la liberté
et des chrétiens», «monde de l'impossible, et son aspiration à gagner l'autre
camp s'épuisait en chimères et rêveries». Else franchira cependant le pas,
épousant, tour à tour, un doux poète aboulique, Fritz Schwiefert, et Erich
Schrobsdorff, aristocrate bibliophile et hors du monde, et mettant au monde la
petite Bettina d'un Hans Huber, roc teuton aux bons yeux larmoyants.
Else se lancera à corps et coeur perdus dans le tourbillon des années folles,
conjurant la menace de la peste brune, et se réfugiant avec ses enfants en
Bulgarie pour échapper aux menaces antisémites, icône consentante et déboussolée
de la folie guerrière et humaine.
Le récit d'Angelika Schrobsdorff est désossé, écrit à la pointe sèche, il évacue
le kitsch propre aux témoignages filiaux.
Angelika Schrobsdorff reçoit dans sa belle maison du quartier d'Abou Thor, à
Jérusalem, silhouette juvénile, à l'arête, frêle et forte à la fois. Depuis la
terrasse, se déploie l'Orient charmeur des cartes postales. Et là, dans un coin
du panorama, le mur de sécurité qui désormais sépare Jérusalem d'Abou Dis. Le
chat Bismarck («Il lui ressemble, non ?») jette un regard soupçonneux sur la
scène.
«Il faut que je parte de ce monde, tout est devenu si compliqué, je suis trop
vieille; tout ici est si vulgaire, si bruyant. Le Levant m'attirait, cela me
dégoûte... J'aime encore le désert de Judée, j'aime Jéricho, quand je suis
déprimée, je m'évade.» Elle est installée en Israël depuis 1983, après une
première visite en 1961 : «Je ne savais rien du pays et des Juifs. Ma mère ne me
laissait pas dire le mot "juif".» Ilse Hirsch, amie de sa mère, «si optimiste à
vous rendre malade», l'invite : «A 4, 5 ans j'étais amoureuse d'elle ; mon frère
Peter l'avait connue. Je suis restée ici trois mois, elle fut une sorte de mère
pour moi, femme forte et chaleureuse. Je suis tombée amoureuse de Jérusalem,
cette ville divisée, et qui le reste, mais je suis attirée par les frontières.
C'est alors que j'aurais dû prendre la décision de rester, et non en 1983.»
Un premier livre en 1961 lui offre succès et argent en Allemagne : «Je ne peux
supporter les Allemands, s'agace-t-elle. Mon animosité, mon amertume ont
disparu, mais je déteste les petits-bourgeois, ils m'horripilent, ils n'ont pas
changé. Ils ont essayé, pourtant. Certains souffrent, les sensibles, ceux qui
réfléchissent. Et ils viennent ici, de jeunes protestants volontaires, afin de
comprendre...» Après guerre, à son retour en Allemagne, après ses «vacances en
Bulgarie», elle confesse avoir «usé de l'arme de [sa] beauté et de [sa]
jeunesse» : «Je haïssais les Allemands, mais ils étaient ceux que je
connaissais, ma langue aussi. En 1949, après mon divorce, j'étais bloquée là,
sans éducation, mais j'ai beaucoup lu. J'étais paresseuse, les hommes me
couraient après. Se suicider, alors ? J'ai écrit.»
Angelika montre une photo d'elle, enfant au regard éperdu devant son père : «Il
était faible, lent, toujours un livre à la main. Ma mère disait : la destruction
(sous les bombes) de sa bibliothèque l'a détruit. Il était très dépendant d'un
père glacial, un junker qui avait déchu pour faire du commerce.» Elle confesse
sa longue détestation de la culture, et «surtout de la culture allemande», «à
cause de mon père. Dans sa tour d'ivoire, et pas le moindre geste de résistance
contre le cours des choses».
Ce livre, Angelika l'a ruminé pendant quinze ans : «Je hais le sentimentalisme.
En ouvrant la boîte de Pandore, j'avais peur de perdre mon humour, mais je
tenais à le publier à cause des lettres de ma mère ; elle a écrit jusqu'à son
dernier jour.» Elle n'a connu Peter Schwiefert, son demi-frère, que par ses
lettres. «Nous nous ressemblions, mais il ne pouvait rien me dire de son rôle
dans la Résistance française. Longtemps, je n'ai pas osé ouvrir ses lettres, et
là, je l'ai trouvé, j'ai tout trouvé.»
Longtemps, son milieu à Jérusalem a été celui, «merveilleux», des «Yekkés», des
Juifs allemands. Ce milieu n'est plus, ou en voie d'extinction. «J'ai un amour
inexplicable pour Jérusalem, j'aime mon quartier, même si ça me tue. Jadis,
j'étais une sorte de paysanne bulgare, je me sens bien en Bulgarie...» En
revanche, Angelika avoue «ne pas se sentir part du peuple israélien». «Je suis
juive, c'est une énorme différence. Je suis horrifiée, profondément triste, je
quitterais volontiers ce pays, mais je suis trop vieille, je ne peux revenir en
Allemagne, où j'aurais une vie meilleure, mais ils nous ont jetées, ma mère et
moi.» Elle n'a pas non plus de bons souvenirs de la France, où elle a vécu
pendant les quelques années de son mariage avec Claude Lanzmann, qu'elle a
rencontré en 1970, à Jérusalem. «Hormis Paris, je ne connais pas la France. J'ai
aimé Marseille, mais ce n'est pas la France, elle est si orientale...»
Prisonnière de Jérusalem ? «Non, j'ai eu des années heureuses, j'ai de la
gratitude pour les gens, j'étais perdue, détruite physiquement et
psychologiquement. Le pays et les gens m'ont changée, je regrette seulement ce
qui arrive en ce moment.» «Au fond, soupire-t-elle, cette maison m'attendait,
Lanzmann m'a aidée à l'acquérir. Ma première nuit ici a été heureuse. Tout
valait la peine parce que j'ai cette maison.» «Le problème juif était trop grand
pour moi jusque-là. Ce pays est grotesque, tout ce patriotisme, ces deuils, ça
me rend malade. Je ne peux supporter cette atmosphère : tant que Juifs et Arabes
ne se regarderont pas comme des êtres humains...» Elle a donc écrit sur la
première Intifada ; elle n'a plus d'engagement politique désormais, mais elle se
désole toujours sur le sort des Palestiniens : «Ils ne peuvent pas bouger, et je
ne les admire pas pour autant. Mais mon sens de la justice ne peut supporter ce
qu'ils endurent. Leur dignité, leur orgueil, on fait tout pour le leur enlever.»
Angelika Schrobsdorff serait la dernière à succomber au «syndrome de Jérusalem»,
qui jette dans le mysticisme des tombereaux de touristes et autres citoyens de
la ville. «En Bulgarie, j'allumais des cierges, je priais le bon Dieu aux yeux
bleus, aux joues rouges, à la grande barbe blanche pour que les Allemands
perdent la guerre. Baptisée protestante, j'ai voulu revenir au judaïsme, grâce à
un merveilleux rabbin...» Elle se souvient surtout du ridicule du rituel devant
le tribunal rabbinique. «Lors de mon premier Kippour, j'ai essayé, mais je ne
voulais pas me mentir : j'ai allumé une cigarette. Le Grand Joker cynique ne m'a
pas eue.»
Désormais, elle dit être «ici», mais «n'appartenir à rien», avoir «tout raté».
Avec un rien de coquetterie. «Bon, c'est vrai : j'ai de belles blessures et de
beaux espoirs...» Elle est là, dans une sorte de no man's land, à l'exacte image
d'Abou-Thor, où la frontière entre Israéliens et Jordaniens passait jusqu'en
1967 au milieu de la rue, où se côtoient encore, sans se mélanger, Juifs et
Arabes.
(1) Peter Schwiefert est l'auteur de «L'oiseau n'a plus d'ailes», recueil de ses
lettres édité par Claude Lanzmann, Gallimard, 1974.